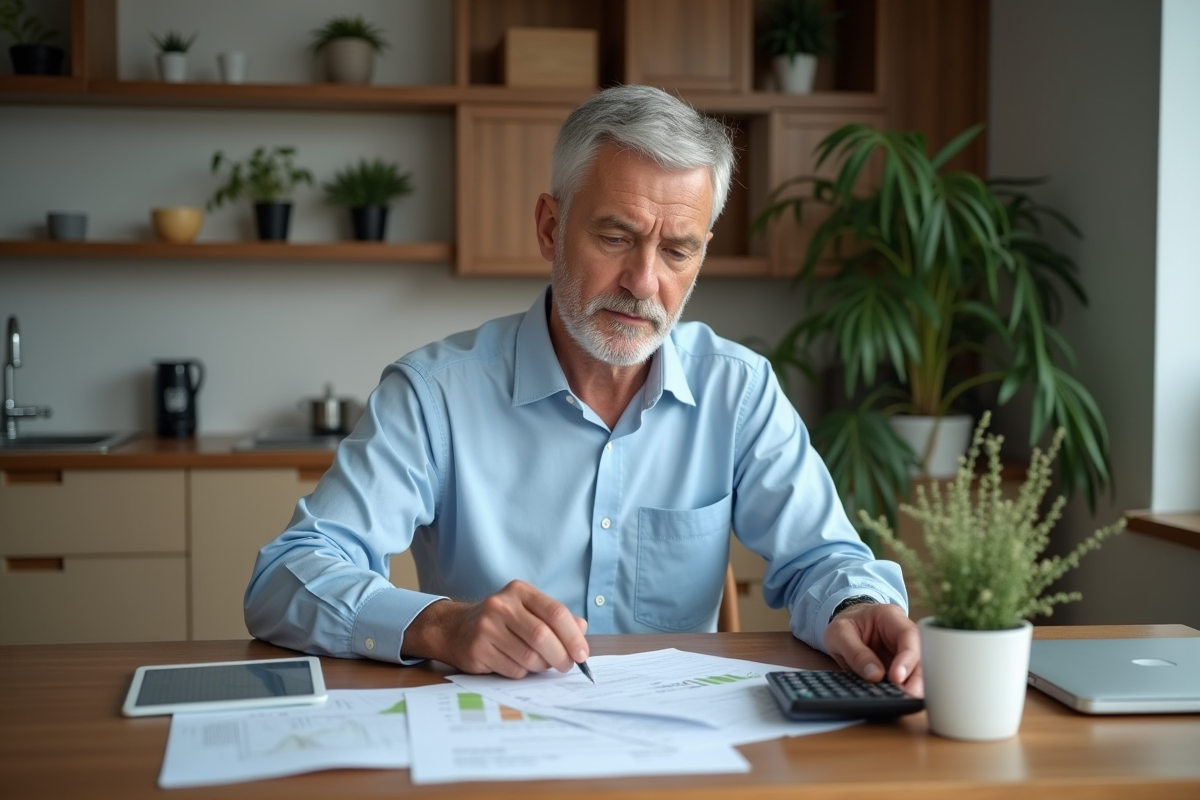Seule une partie de la CSG prélevée sur les revenus locatifs peut être déduite du revenu imposable, créant une différence notable avec d’autres catégories de revenus soumis aux prélèvements sociaux. Les règles applicables varient selon le régime fiscal choisi et la date d’encaissement des loyers, ce qui modifie le montant effectivement déductible d’une année à l’autre.
Pour l’imposition des revenus 2025-2026, le taux de CSG reste fixé à 9,2 %, mais la part déductible ne dépasse pas 6,8 %. Ce mécanisme soulève des interrogations récurrentes au moment de calculer le revenu net foncier imposable.
La CSG sur les revenus locatifs : pourquoi tout le monde en parle ?
La contribution sociale généralisée (CSG) s’impose, sans faiblir, comme un point de friction majeur pour les propriétaires bailleurs. Les prélèvements sociaux qui grèvent les revenus fonciers constituent un véritable casse-tête fiscal. La question n’est pas anodine : taux d’imposition, modalités de calcul, part déductible… chaque détail compte et vient bouleverser la donne pour ceux qui perçoivent des loyers.
Sur le papier, le schéma paraît limpide : chaque euro perçu déclenche une double imposition entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux (17,2 %), dont la CSG tient la plus grande part à 9,2 %. Mais pour qui gère un bien, rien n’est jamais aussi simple. Seule une fraction, 6,8 %, peut être déduite. Ce détail, loin d’être anecdotique, pèse lourd dans le calcul du revenu imposable final.
La tension monte d’un cran lorsque la législation modifie les règles : taux, modalités de déduction, tout évolue et vient chambouler la rentabilité attendue. Dans ce climat d’incertitude, les propriétaires scrutent la moindre variation, car chaque ajustement rejaillit directement sur leur stratégie de gestion. En France, la fiscalité des revenus locatifs évolue sans cesse ; il suffit d’une modification des règles pour bouleverser la rentabilité d’un investissement.
Impossible de passer à côté de ces termes : CSG, prélèvements sociaux, taux applicables, fiscalité des revenus fonciers. Ils reviennent sans cesse dans les échanges, preuve que la question ne laisse personne indifférent. Ces quelques pourcentages que l’on verse à la sécurité sociale deviennent le point d’équilibre entre rendement sur le papier et réalité du compte bancaire. Un terrain mouvant, où chaque décision du législateur peut rebattre toutes les cartes.
Quels revenus fonciers sont concernés et à quels taux s’attendre en 2025-2026 ?
Impossible d’échapper aux prélèvements sociaux quand on perçoit des loyers issus d’une location nue. Deux régimes fiscaux existent pour déclarer ces revenus fonciers : le micro-foncier pour ceux dont les revenus locatifs annuels ne dépassent pas 15 000 €, et le régime réel à partir de ce seuil ou pour ceux qui souhaitent optimiser la déduction de leurs charges.
Peu importe le régime, la CSG s’applique. Tous les propriétaires déclarant des revenus fonciers, qu’ils relèvent du micro-foncier ou du réel, sont soumis aux prélèvements sociaux. En 2025-2026, le taux total reste fixé à 17,2 % : 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité.
La location meublée suit une logique à part. Les loyers issus d’une location meublée non professionnelle (LMNP) relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, mais les prélèvements sociaux s’appliquent tout de même, sauf dans le cas précis où le bailleur cotise déjà au régime social des indépendants, comme c’est le cas pour les loueurs en meublé professionnels.
Pour calculer l’assiette de ces prélèvements, on retient le revenu fiscal de référence, après abattement ou déduction des charges selon le régime choisi. Impossible d’y échapper : même si vous optimisez via le déficit foncier, tout revenu locatif net positif déclaré sera soumis à ces prélèvements. Il devient donc indispensable d’intégrer cette réalité dans le calcul de la rentabilité de votre investissement locatif.
Comment fonctionne la CSG déductible : explication simple d’un calcul souvent flou
La part déductible de la CSG intrigue de nombreux bailleurs. Sur les 9,2 % de CSG prélevés sur les revenus fonciers, seule une fraction, 6,8 %, peut venir alléger le revenu imposable, et ce, l’année suivante. Pour ceux dont le taux marginal d’imposition est élevé, ce dispositif prend tout son sens.
Imaginons un propriétaire au régime réel, percevant 10 000 € de loyers nets : il règle 1 720 € de prélèvements sociaux, dont 920 € de CSG. L’année suivante, 680 € (6,8 % de 10 000 €) seront retranchés de son revenu imposable. La déclaration de cette somme se fait en ligne 6DE de la déclaration 2042. Résultat : une diminution du résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Voici comment se présente ce calcul en pratique :
- Loyers nets imposables : 10 000 €
- CSG payée : 920 € (9,2 % de 10 000 €)
- CSG déductible : 680 € (6,8 % de 10 000 €)
- Montant à retrancher du revenu foncier de l’année N+1 : 680 €
Il faut rappeler que seule la fraction de CSG effectivement versée (et non compensée par un crédit d’impôt) est admise dans la catégorie des charges déductibles. Ce détail, souvent noyé dans la masse de chiffres, pèse pourtant sur le rendement net de ceux qui investissent dans la pierre. Pour qui souhaite optimiser sa déclaration fiscale, la vigilance s’impose.
L’impact réel des prélèvements sociaux sur la rentabilité de vos loyers
Les prélèvements sociaux ne laissent personne indifférent : à 17,2 %, ils réduisent sensiblement la rentabilité locative. La fiscalité immobilière française impose d’intégrer cette réalité : chaque euro de loyer perçu ne se retrouve jamais entièrement dans la poche du propriétaire, une part non négligeable étant prélevée au profit de la sécurité sociale et du budget de l’État.
Si l’on regarde les chiffres, la baisse du rendement est palpable. Pour un loyer annuel net de charges de 12 000 €, le gain réel, une fois les prélèvements sociaux déduits, n’atteint plus que 9 816 €. Et ce calcul s’arrête avant même d’intégrer l’impôt sur le revenu. Le déficit foncier, souvent avancé pour alléger la facture, ne suffit pas toujours à compenser l’impact cumulé des charges déductibles et des prélèvements.
Il existe donc un véritable enjeu dans le choix du régime fiscal. Le régime réel permet de retrancher les charges, mais la base imposable n’échappe pas à la CSG et consorts. Le micro-foncier, lui, applique un abattement, mais sans tenir compte des dépenses réelles. D’un régime à l’autre, la rentabilité locative nette peut changer du tout au tout.
Ceux qui raisonnent à long terme l’ont bien compris : il ne suffit plus de viser un rendement brut alléchant. Ce sont les chiffres nets, après fiscalité et prélèvements sociaux, qui dictent la performance réelle d’un investissement. À l’heure des choix patrimoniaux, la pression fiscale sur les revenus fonciers pèse autant que la gestion des travaux ou la vacance locative. Au bout du compte, chaque point de rentabilité grignoté par la CSG éloigne un peu plus la promesse initiale du rendement théorique. Voilà la réalité à laquelle se frottent, chaque année, des milliers de bailleurs.